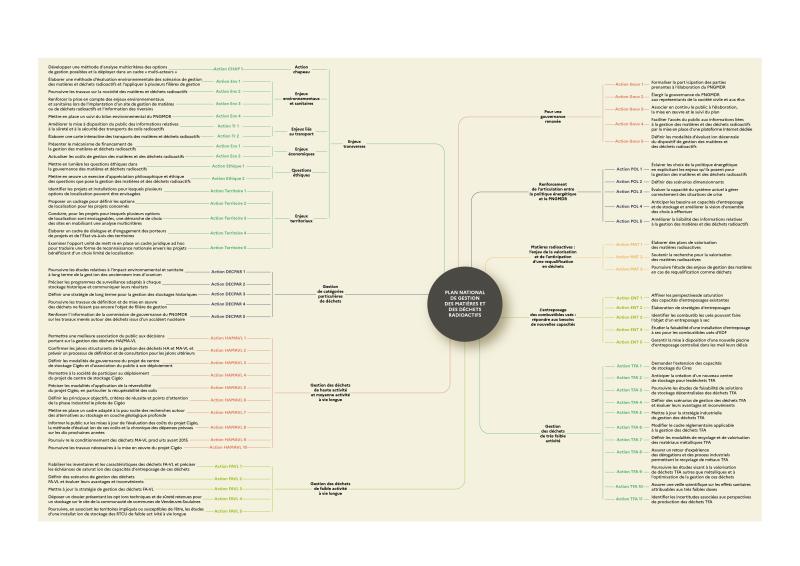Annexes
-
Publié le 23.12.2022
-
Modifié le 19.08.2024
Partager la page
La gestion des matières radioactives
| Indicateurs | Action(s) associée(s) | |
|---|---|---|
| I1 | Taux de remplissage des entreposages d'Uapp | MAT.1 |
| I2 | Taux de remplissage des entreposages d’URT* | |
| I3 (nouveau) | Nombre de matières faisant l’objet d’un plan de valorisation (obj 100 % fin PNGMDR*) | |
L’entreposage des combustibles usés
| Indicateurs | Action(s) associée(s) | |
|---|---|---|
| I1 | Taux de remplissage des entreposages de combustible uséde remplissage des entreposages d'Uapp | ENT.1 |
| I2 (nouveau) | Ratio du nombre de jalons prévus par le plan atteints sur le nombre total (obj 100 % fin plan avec suivi de l’avancement annuel) | |
Modalités de gestion des déchets de très faible activité
| Indicateurs | Action(s) associée(s) | |
|---|---|---|
| I1 | Suivi par exploitant du volume annuel de déchets TFA* produits par site et conditionnés sous forme de colis définitifs qui ne seraient pas évacués en moins de 24 mois vers le Cires* | TFA.1 à TFA.5 |
| I2 | Suivi par exploitant des volumes de déchets TFA* produits par site (hors déchets TFA* historiques et en attente de filière) en attente ou en courts de conditionnement depuis plus de 24 mois | |
| I3 | Ratio volume de déchets TFA* historiques produits / volume de déchets TFA* historiques évacués | |
| I4 | Suivi de la capacité volumique du Cires* | |
| I5 | Suivi des capacités radiologiques du Cires*, par radionucléide | |
| I6 | Suivi de la densité des déchets stockés au Cires*. [Objectif : augmentation de la densité – objectif à préciser ultérieurement] | |
| I7 (nouveau) | Suivi de la part de déchets métalliques TFA* français valorisés (pertinent à compter de la mise en service de l’installation de valorisation) | TFA.7 |
| I8 (nouveau) | Ratio du nombre de jalons prévus par le plan atteints sur le nombre total (obj 100 % annuellement sur les jalons de l’année) | TFA.5 |
Modalités de gestion des déchets de faible activité à vie longue
| Indicateurs | Action(s) associée(s) | |
|---|---|---|
| I1 | Taux de remplissage des entreposages de déchets FA-VL* par catégorie | FAVL.2 et FAVL.3 |
| I2 (nouveau) | Ratio du nombre de jalons prévus par le plan atteints sur le nombre total (obj 100 % annuellement sur les jalons de l’année) | FAVL.3 |
Modalités de gestion des déchets HA* et MA-VL*
| Indicateurs | Action(s) associée(s) | |
|---|---|---|
| I1 | Taux de remplissage des capacités d’entreposage de l’ensemble des colis vitrifiés CSD-V* sur le site de La Hague (exprimé en capacité disponible sur la production annuelle de CSD-V*) | HAMAVL.10 |
| I2 | Taux de remplissage des capacités d’entreposage de colis CSD-C* sur le site de La Hague (exprimé en capacité disponible sur la production annuelle de CSD-C*) | |
| I3 | Taux de remplissage des capacités d’entreposage de colis C1PG sur le site du Bugey | |
| I4 | Taux de remplissage des capacités d’entreposage de colis de boues bitumées sur le site de Marcoule | |
| I5 | Taux de remplissage des capacités d’entreposage de colis dits DIADEM sur le site de Marcoule | |
| I6 | Taux de remplissage des capacités d’entreposage de colis dits MI sur le site de Cadarache | |
| I7 | Taux de remplissage des capacités d’entreposage de colis dits FI sur le site de Cadarache | |
| I8 (nouveau) | Ratio du nombre de jalons prévus par le plan atteints sur le nombre total (obj 100 % annuellement sur les jalons de l’année) | HAMAVL |
Gestion des déchets particuliers
| Indicateurs | Action(s) associée(s) | |
|---|---|---|
| I1 | Suivi de la quantité d’amiante stockée au Cires* et au centre de stockage de l’Aube afin de vérifier la compatibilité des possibilités de stockage avec les déchets produits et à produire. | Action DECPAR.4 |
| I2 | Pourcentage de traitement des déchets de type huiles et liquides organiques produits avant 2015 (objectif de 50 % à 2025 et de 100 % à 2035). | |
| I3 | Pourcentage de déchets activés des petits producteurs produits avant 2015 faisant l’objet d’une filière de gestion définitive (objectif de 100 % en 2030). | |
| I4 | Pourcentage de déchets sans filière produits avant 2015 faisant l’objet d’une filière de gestion définitive (objectif : la définition d’une filière de gestion définitive pour l’ensemble des déchets sans filière produits avant 2015 est attendue d’ici à 2030). | |
| I5 | Volume et activité des déchets tritiés ne disposant pas d'une filière de gestion | |
| I6 (nouveau) | Volume de sources scellées en attente de prise en charge dans une filière définitive de gestion | |
Enjeux transverses à la gestion des matières et déchets radioactifs (nouveau)
| Indicateurs | Action(s) associée(s) | |
|---|---|---|
| I1 | Nombre de familles de déchets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique | ENV.1 |
| I2 | Nombre de familles de déchets auxquelles la méthode d’analyse de la nocivité aura été appliquée | ENV.2 |
| I3 | Ratio du nombre de jalons prévus par le plan atteints sur le nombre total (obj 100 % fin plan et suivi avancement annuel) | Chapitre 10 |
(Accords en vigueur, énumérés dans l’ordre chronologique)
1 – Pays-Bas
a) Accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, relatif au traitement en France d’éléments combustibles irradiés, signé à Paris le 29 mai 1979.
b) Accord modificatif en date du 9 février 2009 publié au Journal officiel par décret n° 2010-1167 du 30 septembre 2010.
2 – Suède
Échange de lettres constitutif d’accord entre la France et la Suède, relatif aux contrats conclus entre la COGEMA et la société suédoise SKBF en vue du retraitement par la COGEMA de certaines quantités de combustible irradié en provenance de Suède, signé le 10 juillet 1979.
3 – Espagne
Échange de notes constitutif d’accord entre la France et l’Espagne sur les déchets radioactifs provenant de combustibles irradiés produits par la centrale nucléaire de Vandellos I, signé le 27 janvier 1989.
4 – Italie
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne portant sur le traitement de 235 tonnes de combustibles nucléaires usés italiens, signé à Lucques le 24 novembre 2006 et publié au Journal officiel par décret n° 2007-742 du 7 mai 2007.
5 – Allemagne
Accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, relatif au transport de la République française vers la République fédérale d’Allemagne de colis de déchets radioactifs provenant du retraitement du combustibles irradiés, signé à Paris les 20 et 28 octobre 2008 et publié au Journal officiel par décret n° 2008-1369 du 19 décembre 2008.
6 – Pays-Bas
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif au traitement en France d’éléments combustibles irradiés néerlandais, signé à La Haye le 20 avril 2012 et publié au Journal officiel par décret n° 2013-1285 du 27 décembre 2013.
7 – Belgique
Accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, relatif au traitement de combustibles usés belges à La Hague, signé à Paris le 25 avril 2013 et publié au Journal officiel par décret n° 2014-835 du 23 juillet 2014.
8 – Australie
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif au retraitement en France d'éléments combustibles nucléaires irradiés australiens, signé à Canberra le 23 novembre 2017 et publié au Journal officiel par décret n° 2018-586 du 6 juillet 2018.
La recherche en sciences humaines et sociales a pour objet d’intégrer une dimension sociétale aux différents projets relatifs à la gestion des déchets et à son articulation dans une perspective transdisciplinaire. Les études menées concernent plus particulièrement la gestion des déchets les plus radioactifs qui soulèvent des questions complexes relatives à la nécessité d’appréhender des événements sur de longues échelles de temps. La question de la préservation et de la transmission de la mémoire à long terme, au-delà de la fermeture des centres de stockage nécessite notamment d’être anticipée.
Dimension sociétale
L’intervention des Sciences Humaines et Sociales (SHS) dans le domaine de la gestion des déchets et des matières radioactives se justifie en amont par la volonté de rendre plus robustes les différentes solutions préconisées. L’acceptabilité de celles-ci, qui relève in fine de l’ordre politique, est facilitée lorsqu’on aborde l’ensemble des phénomènes impliqués dans un cadre adapté, sans négliger leurs dimensions socio-économiques, environnementales, politiques, culturelles… et que l’on articule les différentes perspectives scientifiques et techniques en jeu. Une R&D unidimensionnelle et fermée sur elle-même a peu de chances de faire réussir les projets techniques, comme le montre l’histoire de la gestion des déchets nucléaires en France d’avant 1991. La recherche en SHS a donc pour objet d’intégrer les dimensions sociétales des différents projets en cours et leur articulation dans une perspective transdisciplinaire. Les collaborations avec des chercheurs issus de ces disciplines doivent viser, dès le départ, la constitution de communautés spécialisées autour de sujets d’intérêt commun avec les opérateurs et les parties prenantes.
Les recherches de l’Andra* dans le domaine des SHS s’attachent aux dimensions sociétales (socio-économiques, politiques, culturelles…) des projets de l’agence et visent ainsi à améliorer la robustesse de ceux-ci dans une perspective transdisciplinaire. La thématique de la réversibilité a été privilégiée à ce titre dans un premier temps, donnant lieu à plusieurs manifestations scientifiques et publications, ainsi qu’à la réalisation d’une thèse de doctorat en sciences économiques. L’Andra* cherche actuellement à développer cette démarche durablement par la mise en place d’un groupement de laboratoires interdisciplinaire en sciences humaines et sociales autour de la thématique générale « transmission intergénérationnelle et appréhension des longues échelles de temps ». Le choix de cette thématique se justifie par le fait que la dimension temporelle impliquée dans les activités de l’Andra*, en particulier dans la gestion de déchets les plus radioactifs, est en effet unique en comparaison avec d’autres domaines industriels. Cette spécificité soulève des questions d’une très grande complexité qui concernent notamment la capacité d’anticiper et d’appréhender des événements sur des longues durées et en assurer leur maîtrise.
D’autres sujets de recherche, moins avancés dans leur définition, pourraient être intégrés dans ce cadre dans un avenir proche, en particulier dans les domaines de l’économie du long terme et des études environnementales, ou suscitées par les nouveaux programmes en SHS du CNRS et l’IRSN*, en cours de mise en place.
Le programme NEEDS (Nucléaire, Énergie, Environnement, Déchets, Société) du CNRS intègre les SHS dans la réflexion sur le nucléaire et envisage d’aborder la question de la temporalité d’une manière plus générale, sous l’angle de la gestion et de l’évaluation des risques. Ce programme entend également capitaliser les connaissances acquises en SHS sur le thème des déchets nucléaires, à partir notamment des nombreux travaux réalisés au CNRS sur cette question.
Concepts et plans pour la période postérieure à la fermeture
Cas des installations classées pour la protection de l’environnement
Le Cires*
L’exploitation de l’installation de stockage des déchets TFA* au Cires* est encadrée par l’arrêté 2016-020-0003 du 20 janvier 2016 autorisant l’exploitation de cette première installation classée pour la protection de l’environnement dédiée au stockage de déchets radioactifs. Cet arrêté s’inspire de la réglementation applicable au stockage de déchets dangereux (arrêté ministériel du 30 décembre 2002 modifié). Par ailleurs, l’Andra* a souhaité suivre la même méthodologie pour l’évaluation de l’impact à long terme du centre de stockage des déchets TFA* que celle déjà suivie pour les centres de stockage de déchets de faible et moyenne activité, le centre de stockage de la Manche et le centre de stockage des déchets FMA de l’Aube.
Conformément à l’arrêté d’autorisation d’exploiter du Cires* du 20 janvier 2016 (article 1.7.6), l’Andra* proposera au préfet un projet définissant des servitudes d’utilité publique à instituer sur tout ou partie de l’installation au plus tard un an après la fin de la période d'exploitation. Ces servitudes pourront interdire l’implantation de constructions et d’ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles devront aussi assurer la protection des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et le maintien durable du confinement des déchets mis en place. Par ailleurs, la phase de post exploitation sera destinée à suivre, pendant au moins trente ans après le dernier apport de déchets, l’évolution du stockage et sa conformité par rapport aux prévisions et à l’arrêté préfectoral. À cette fin, des contrôles seront maintenus, notamment :
- l’entretien régulier du site (fossés, couverture, bassins, clôture…) ;
- les observations géotechniques du site avec un report régulier au moins annuel sur un plan topographique ;
- des mesures périodiques portant sur la qualité des eaux collectées sur le centre et rejetées dans l’environnement ainsi que des contrôles des compartiments de l’écosystème dans l’environnement proche du centre de stockage des déchets TFA*.
L’ensemble de ces mesures sera destiné à vérifier l’absence de pollution radioactive ou chimique dans l’environnement du centre. Le cas échéant, elles permettront de mettre en évidence de façon précoce des anomalies de comportement et d’anticiper d’éventuelles actions de remédiation.
À l’issue de la phase de post exploitation, le maintien de la mémoire repose en particulier sur les servitudes inscrites a minima au registre des hypothèques.
Cas des INB*
Le cadre législatif applicable aux installations nucléaires de base pour la période postérieure à la fermeture des installations s’appuie notamment :
- sur la loi relative à la croissance énergétique pour la croissance verte (article L.593-31 du code de l’environnement) qui précise les dispositions concernant l’arrêt définitif et le démantèlement des installations de stockage de déchets radioactifs ;
- sur la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (TSN, loi n° 2006 686 du 13 juin 2006 codifiée) qui précise que le passage en phase de surveillance d’une INB est soumis à autorisation (article L. 593-25 du code de l’environnement) et que l’autorité administrative peut instituer des servitudes d’utilité publique autour de cette INB* (article L. 593-5 du code de l’environnement) ;
- sur l’article R.593-16 du code de l’environnement qui précise le contenu du dossier de demande d’autorisation de passage en phase de surveillance. Ce dossier contient notamment : l’étude d’impact, un rapport de sûreté, une étude de maîtrise des risques, le plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance et le cas échéant, les servitudes d’utilité publique (cf. article 43 de ce décret) ;
- sur l’arrêté du 7 février 2012 qui fixe les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. Cet arrêté dispose au Chapitre V relatif aux stockages de déchets radioactifs que : « Dans le respect des objectifs énoncés par l’article L. 542-1 du code de l’environnement, le choix du milieu géologique, la conception et la construction d’une installation de stockage de déchets radioactifs, son exploitation et son passage en phase de surveillance sont définis de telle sorte que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement soit assurée de façon passive vis-à-vis des risques présentés par les substances radioactives ou toxiques contenues dans les déchets radioactifs après le passage en phase de surveillance. Cette protection ne doit pas nécessiter d’intervention au-delà d’une période de surveillance limitée, déterminée en fonction des déchets radioactifs stockés et du type de stockage. L’exploitant justifie que la conception retenue répond à ces objectifs et justifie sa faisabilité technique. »
Le centre de stockage de la Manche
D’un point de vue réglementaire, le centre de stockage de la Manche (CSM*) est une INB* (n° 66) dédiée au stockage de déchets de faible et moyenne activité à vie courte, en surface. Le décret d’autorisation de création date de juin 1969. Le passage de l’installation en phase de surveillance a été autorisé par décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003. Cette phase de surveillance est prévue conventionnellement pour une durée de trois cents ans et assortie d’une autorisation de rejets datée en date 10 janvier 2003. En 1996, sur la base des conclusions de la Commission d’évaluation de la situation du centre de stockage de la Manche (dite « Commission Turpin »), il a été pris acte que « le site ne pourra pas être banalisé » après cette période de surveillance. L’Andra* a donc retenu la nécessité de conserver, et à terme, de transmettre la mémoire du site et de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la nature des constructions ou équipements qui pourraient y être installés.
Les concepts et plans pour la période postérieure à la fermeture comprennent :
- la conception de l’installation, la surveillance et le maintien de la mémoire :
- les dispositions relatives à la conception ont été prises par l’exploitant durant la phase d’exploitation. Ainsi le stockage après fermeture correspond à un tumulus dans lequel les colis de déchets stockés dans des ouvrages sont protégés des agressions climatiques par une couverture de faible perméabilité ; un système de gestion des effluents permet de récupérer les eaux infiltrées à travers la couverture et/ou dans le stockage. Les eaux récupérées font l’objet d’un transfert vers l’installation de traitement d’Orano La Hague, conformément à l’arrêté d’autorisation de rejets ;
- le décret n° 2003-30 d’autorisation de passage en phase de surveillance mentionne que l’exploitant assure une surveillance appropriée de l’installation et de son environnement. Celle ci est définie dans le plan réglementaire de surveillance qui intègre la surveillance de la couverture, du confinement des ouvrages de stockage et des rejets du centre. Ce plan précise que les résultats sont régulièrement diffusés auprès de l’ASN* (rapport annuel) et du public (synthèse du rapport annuel présentée à la CLI*). Le décret définit également que la protection de l’installation contre les risques d’intrusion et les actes de malveillance est assurée pendant toute la phase de surveillance. De plus, le décret précise que, tous les dix ans, l’exploitant étudie l’opportunité de faire évoluer les dispositions de surveillance et de protection de son installation.
- en termes de maintien de la mémoire de l’installation, trois axes sont identifiés :
- des dispositions documentaires avec :
- l’archivage à long terme des informations : le décret n° 2003-30 définit les attendus liés à l’archivage à long terme des informations ;
- le dossier détaillé de mémoire : les documents sont dupliqués sur papier permanent et sont archivés en deux lieux distincts, au Centre de stockage de la Manche et aux Archives nationales de France. Des versements complémentaires sont réalisés au long de la vie du centre et jusqu’au terme de la phase de surveillance ;
- le dossier synthétique de mémoire : une première version de ce document d’une centaine de pages a été soumise à l’ASN* et à la CLI* en 2008. Ce document est révisé au fur et à mesure des examens de sûreté pour y intégrer le retour d’expérience de la surveillance. Lorsqu’il sera considéré comme stabilisé, et au plus tard à la fin de la phase de surveillance, il sera imprimé sur papier permanent et largement diffusé conformément à ce que prévoient les prescriptions techniques.
- des dispositions documentaires avec :
- l’information du public, notamment pendant la phase de surveillance, via notamment les échanges avec la CLI* et via les actions de communication ;
- le projet de demande d’instauration de servitudes d’utilité publique pour limiter le risque d’intrusion dans le stockage le plus longtemps possible au-delà de la phase de surveillance. De telles servitudes ont été suggérées par la commission Turpin et envisagées par l’Andra*, dès le rapport de sûreté de 2009, en application de l’article 31 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006.
Le centre de stockage de l’Aube
D’un point de vue réglementaire, le centre de stockage des déchets FMA* de l’Aube (CSA*) - qui a pris le relais du centre de stockage de la Manche (CSM*) - est également une INB* (n° 149). Le décret d’autorisation de création, datant du 4 septembre 1989, a été modifié par le décret n°2006-1006 du 10 août 2006 assorti de l’arrêté d’autorisation de rejets du 21 août 2006.
En ce qui concerne la période après-exploitation, le décret d’autorisation de création du centre de stockage des déchets FMA* prévoit notamment que : (i) pendant la phase de surveillance, « les ouvrages seront protégés par une couverture de très faible perméabilité » et « l’installation continuera d’être surveillée pendant une durée permettant la décroissance radioactive des radionucléides de période courte ou moyenne, jusqu’à un niveau ne présentant plus de risque radiologique significatif. » ; (ii) à l’issue de la phase de surveillance, « les terrains occupés par l’installation devront pouvoir être utilisés normalement sans restriction de nature radiologique […] au plus tard 300 ans après la fin de la phase d’exploitation ».
En complément à l’aspect réglementaire, l’Andra* suit également les recommandations de la RFS I.2 qui définit les objectifs fondamentaux de sûreté pour les centres de surface destinés au stockage de déchets radioactifs solides FMA-VC*, en particulier les bases de conception d’un stockage et la surveillance de l’installation durant les phases d’exploitation et de surveillance.
À l’instar du CSM*, les concepts et plans pour la période postérieure à la fermeture du centre de stockage des déchets FMA* comprennent : la conception de l’installation, la surveillance et le maintien de la mémoire :
- les dispositions relatives à la conception sont prises par l’exploitant durant la phase d’exploitation conformément à ce que prévoit la RFS I.2 :
- la limitation de l’activité initiale : les déchets radioactifs admis au centre de stockage des déchets FMA* sont des déchets à période courte ou moyenne avec des quantités limitées de radionucléides à vie longue, et de faible ou moyenne activité massique. L’objectif est que l’activité des radionucléides stockés ait largement décru pendant les 300 ans de surveillance de l’installation ;
- le confinement des déchets est assuré par le colis et l’ouvrage pendant la phase d’exploitation auxquels s’ajoute la couverture et réseaux de collecte des eaux d’infiltration pendant la phases de surveillance et par la formation géologique sur laquelle est implantée le stockage, en particulier en phase de post surveillance.
- les dispositions relatives à la surveillance de l’installation et de son environnement. À la fermeture du centre, conformément au décret n° 2007-1557, l’Andra* demandera l’autorisation de passage en phase de surveillance et proposera des règles générales de surveillance. Un décret devra autoriser le passage en phase de surveillance. La démarche de surveillance mise actuellement en œuvre dans le cadre de la phase d’exploitation perdurera, dans son principe, pendant la phase de surveillance. Cette surveillance s’appuie sur un certain nombre de mesures (radiologiques, chimiques, hauteurs de nappe phréatique, hydrologiques, climatologiques notamment) dont le suivi dans le temps doit permettre de : (1) vérifier le bon fonctionnement du stockage en s’assurant de l’absence de disséminations inacceptables de radioéléments initialement contenus dans le stockage ; (2) détecter toute situation ou évolution anormale afin d’en identifier et d’en localiser les causes et d’engager les actions correctives nécessaires ; (3) aboutir à une compréhension suffisante des mécanismes d’évolution du stockage ; (4) évaluer l’impact radiologique et chimique du stockage sur la population et l’environnement et de suivre son évolution, afin de vérifier le respect des exigences réglementaires ; (5) assurer la protection de l’installation contre les risques d’intrusion et les actes de malveillance ;
- les dispositions relatives au maintien de la mémoire : l’Andra* s’appuie sur la solution de référence développée pour le CSM*, qui est préparée dès l’exploitation. Par ailleurs la CLI* devrait perdurer en phase de surveillance et permettre ainsi l’information et la concertation du public.
Le stockage en couche géologique profonde Cigéo* en projet
Le guide de sûreté relatif au stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde édicté par l’Autorité de Sûreté en 2008 définit :
- l’objectif fondamental de sûreté : la protection de la santé des personnes et de l’environnement comme l’objectif fondamental de sûreté du stockage. Après la fermeture de l’installation de stockage, la protection de la santé des personnes et de l’environnement ne doit pas dépendre d’une surveillance et d’un contrôle institutionnels qui ne peuvent pas être maintenus de façon certaine au-delà d’une période limitée ;
- les bases de conception et les principes de sûreté ;
- la surveillance et le maintien de la mémoire : un programme de surveillance de l’installation doit être mis en œuvre pendant la construction des ouvrages de stockage et jusqu’à la fermeture de l’installation. Certaines dispositions de surveillance pourraient également être maintenues après la fermeture de l’installation. La nécessité de mettre en œuvre cette surveillance doit être prise en compte dès la conception du système de stockage. La mémoire doit être maintenue après la fermeture du site.
Le projet de stockage Cigéo* est conçu dans une couche géologique profonde, le Callovo-Oxfordien, pour permettre de confiner durablement les substances que contiennent les déchets HA* et MA-VL*. Selon l’Article L. 542-10-1 du code de l’environnement « Un centre de stockage en formation géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base ». Le projet Cigéo* s’inscrit ainsi dans le cadre de la réglementation applicable aux INB* telle que définie en partie 1 de ce PNGMDR*.
Conformément au cadre réglementaire, notamment l’arrêté du 7 février 2012, et du guide de sûreté de l’ASN* susvisé, le projet de stockage Cigéo* est conçu pour évoluer d’une sûreté active à une sûreté totalement passive, où aucune action de l’homme ne sera plus nécessaire. Après l’exploitation, l’installation sera fermée et placée en phase de surveillance.
Comme pour les centres de surface, les concepts et plans pour la période postérieure à la fermeture du projet de stockage Cigéo* comprennent la conception des installations de stockage, la surveillance et le maintien de la mémoire :
- les dispositions relatives à la conception : pour répondre aux objectifs de sûreté après fermeture, le stockage en formation géologique profonde est conçu de manière à pouvoir garantir et démontrer la sûreté en exploitation et à long terme après sa fermeture tant pour l’homme que l’environnement, tout en étant réversible sur une durée d’au moins 100 ans. Conformément à la réglementation et au guide ASN*, l’installation souterraine de stockage une fois fermée devra satisfaire aux objectifs de sûreté après fermeture de manière passive. La sûreté de l’installation repose ainsi sur un ensemble de composants afin de confiner la radioactivité et d’isoler les déchets des possibles agressions externes ;
- les dispositions relatives à la surveillance de l’installation et de son environnement. Des moyens seront mis en place pour maintenir la mémoire et la surveillance le plus longtemps possible. Une surveillance de l’environnement est envisagée avant la construction (état initial), pendant la construction et pendant toute la durée d’exploitation ; elle pourra se poursuivre après la fermeture de l’installation souterraine et le démantèlement des installations d’exploitation en surface. Cette surveillance répondra aux exigences réglementaires des suivis des impacts de l’installation. L’ensemble de ces mesures sera destiné à vérifier l’absence de pollution radioactive ou chimique dans l’environnement du centre et s’assurer ainsi du bon fonctionnement du stockage. L’Observatoire pérenne de l’environnement offre un cadre pour la surveillance de l’environnement avant et pendant la construction et l’exploitation. Par ailleurs, un programme de surveillance est conçu, en particulier en lien avec la sûreté après fermeture pour suivre un certain nombre de paramètres dans l’installation souterraine pendant la phase d’exploitation du stockage. Les moyens mis en œuvre pour la surveillance après fermeture du projet Cigéo* se fonderont notamment sur le retour d’expérience des centres de surface ;
- les dispositions relatives au maintien de la mémoire sont conçues selon un axe privilégié : la transmission aux générations futures pour les informer de l’existence et du contenu de l’installation et pour leur fournir des connaissances leur permettant de comprendre leurs observations, de faciliter d’hypothétiques actions ou de transformer le site. Actuellement la solution de référence retenue par l’Andra* pour assurer la mémoire de ses centres de stockage (voir le paragraphe dédié ci-après) repose sur un dispositif archivistique et règlementaire, aussi appelé « mémoire passive » et sur des interactions diverses avec la société. Ce dispositif de référence doit être mis en œuvre pour le projet de stockage Cigéo* avec une exigence de pérennité de la mémoire après fermeture de l’installation, le plus longtemps possible, et sur cinq siècles au moins. À ce stade du projet, la solution de référence mise en place au centre de stockage de la Manche (CSM*) sert de base pour le dispositif de mémoire à mettre en place pour le projet de stockage Cigéo*.
Projet de stockage des déchets de faible activité à vie longue
L’Andra* s’appuie sur la « note d’orientations générales de sûreté en vue d’une recherche de site pour le stockage de déchets de faible activité massique à vie longue » publiée par l’ASN* en mai 2008. Elle définit ainsi que :
- après la fermeture de l’installation de stockage, la protection de la santé des personnes et de l'environnement ne doit pas dépendre d’une surveillance et d’un contrôle institutionnels qui ne peuvent pas être maintenus de façon certaine au-delà d'une période limitée ;
- pour ce qui concerne la phase de surveillance, le concepteur doit s’interroger sur les moyens d’assurer cette surveillance dès la conception de l’installation de stockage.
Les concepts et plans pour la période postérieure à la fermeture du projet FA-VL* sont étroitement liés aux concepts développés, au(x) site(s) choisi(s) pour l’implantation des stockages ainsi qu’à la nature des déchets stockés. Des dispositions seront prises en matière de surveillance après fermeture du stockage. Elles seront étudiées et précisées au fur et à mesure de l’avancement des études de conception. Elles s’appuieront sur l’ensemble du retour d’expérience de l’exploitant Andra* en la matière sur les autres centres.
La préservation et la transmission de la mémoire des stockages de l’Andra*
Tous les stockages exploités ou en projet de l’Andra* prévoient la mise en place d’un dispositif mémoriel, afin de transmettre la mémoire de ces stockages après leur fermeture. La question de la préservation et de la transmission de la mémoire à long terme au-delà de la fermeture des centres de stockage se situe sur un plan différent de celui de la gestion des connaissances mise en œuvre pour un projet industriel classique. De tels dispositifs de gestion des connaissances sont utilisés à l’Andra* comme ailleurs, et évolueront nécessairement au fil des décennies. Pour autant, cette évolution ne peut garantir la transmission des connaissances et de la mémoire même du stockage sur le très long terme, notamment quand plus aucun centre de stockage ne sera en activité. Il est donc nécessaire de s’interroger, dès maintenant, sur ce dont pourraient avoir besoin les générations futures pour préserver la mémoire du stockage, notamment si des interventions sur le site étaient envisagés.
La solution de référence mise en place par l’Andra*
La problématique de la mémoire des centres de stockage a été prise en compte dès les années 1980 pour le centre de stockage de la Manche. Pour y répondre, une solution d’archivage sur papier permanent a été définie en 1995. En 1996, la commission Turpin a conforté les modalités retenues par l’Andra* et préconisé de nouveaux développements. La solution de référence retenue par l’Andra* pour la mémoire à long terme de ses centres de stockage s’appuie actuellement sur un dispositif archivistique et réglementaire, aussi appelé « mémoire passive » et sur des interactions les plus diverses possibles avec la société.
Le dispositif réglementaire repose sur trois composantes:
- le « dossier détaillé de mémoire » constitué de toute la documentation technique nécessaire à la surveillance, la compréhension et la modification d'un centre de stockage. Un ensemble d’outils de recherche (inventaires, glossaire, index, résumés) en assure l’accessibilité et la compréhension. La pérennité des documents repose sur une sélection adaptée du couple « encre / papier permanent » et la conservation de deux exemplaires sur des sites distincts, le centre de stockage et les Archives nationales. Enfin, la validité et la mise à jour du dossier détaillé de mémoire sont assurées par des versements successifs, tout au long de l’exploitation du stockage et ce jusqu'au terme de la phase de surveillance ;
- le « dossier synthétique de mémoire » est un jeu restreint de documents avec une approche synthétique d'informations techniques et historiques, destiné aux décideurs et aux publics. Une version préliminaire est demandée par la réglementation dès le passage en phase de fermeture du stockage ;
- l’inscription au cadastre de « servitudes d’utilité publique » assurera, au-delà de la période où une intrusion involontaire sur le site est exclue de facto par la présence de l’exploitant, une signalétique administrative du site avertissant du risque potentiel d'entreprendre des travaux sur ce site.
Une évaluation de ce dispositif mémoriel réglementaire intervient a minima à l’occasion des réexamens de sûreté, donc suivant une périodicité décennale.
La diversité des interactions avec les différents publics est illustrée par :
- l’organisation de journées portes ouvertes, de conférences, d’expositions ;
- la diffusion d’outils de communication spécifiques à la mémoire, plaquettes, ouvrages et site Internet ;
- les partenariats avec des producteurs de contenus sur les différents médias, ainsi que l’accompagnement d’initiatives extérieures qui viennent solliciter l’Andra* du fait de leur intérêt pour le thème de la mémoire ;
- la démarche Art et Mémoire, permettant de mobiliser les contributions d’artistes et ainsi d’aborder les publics via un autre angle ;
- l’animation de groupes de riverains, les « groupes Mémoire », qui consacrent du temps à cette question, sont force de proposition et relais local de transmission mémorielle.
L’analyse de l’ensemble de ce dispositif, notamment au regard du retour d’expérience sur la durabilité d’autres dispositifs mémoriels historiques amène à conclure à une bonne confiance pour sa pérennité sur quelques siècles.
Le programme Mémoire de l’Andra*
La solution de référence retenue par l’Andra* ne peut cependant être considérée comme résolvant définitivement la question. Comme tout ce qui concerne le futur des sociétés humaines, la transmission de la mémoire ne peut être démontrée. Il importe donc de maintenir toujours les efforts pour la conforter au maximum. De plus, une conservation de la mémoire assurée pour « seulement » quelques siècles après la fermeture du stockage est estimée trop courte par plusieurs des parties prenantes de ce stockage, notamment pour les futurs riverains. En conséquence, l’Andra* a décidé en 2010 de lancer le programme « Mémoire des stockages de déchets radioactifs pour les générations futures » avec une double finalité : augmenter la robustesse de la solution de référence et développer les réflexions et les études sur la mémoire plurimillénaire.
Le programme Mémoire comprend ainsi quatre axes, tournés vers ce double objectif :
- un axe archivistique et réglementaire, correspondant au développement progressif de la solution de référence pour chacun des sites sous le contrôle de l’ASN* et de son appui technique l’IRSN* ;
- un axe d’interactions sociétales auprès des publics les plus divers, qui vise à conforter dans la société la conscience de l’existence des stockages et d’une quantité d’informations à leur sujet. Les actions menées au titre de cet axe (échanges directs avec les publics, media, groupes Mémoire, etc.) multiplient les traces de l’existence des stockages pour renforcer la robustesse de la transmission mémorielle ;
- un axe d’études et recherches sur les différents processus qui concourent à la transmission mémorielle, de la mémorisation initiale des informations à l’accès et l’interprétation de ces informations dans des futurs plus ou moins lointains, en passant par leur préservation entre le temps initial et ces futurs. Ces travaux mobilisent des disciplines scientifiques variées, dans le domaine des sciences naturelles (sur les matériaux et leur durabilité) et les sciences humaines et sociales (sémiotique et linguistique, socio-anthroplogie, archéologie en particulier) ;
- un axe d’échanges et de collaborations à l’international, qui vise non seulement à confronter les points de vue et partager les connaissances, mais aussi à construire progressivement une couche supplémentaire de robustesse de la transmission mémorielle, qui conforte les niveaux local et national. L’Andra* a ainsi participé activement aux travaux du groupe d’experts « Records, Knowledge and Memory preservation accross generations » (RK&M) sous l’égide de l’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE* (2011-2018) et elle a accueilli la conférence internationale « Construire la Mémoire » organisée dans ce cadre à Verdun en 2014. Les travaux de RK&M se poursuivent au sein de la plateforme « Information, Data and Knowledge Management » (IDKM) et l’Andra* continue à y prendre sa part.
Le programme Mémoire est jalonné par les échéances des projets de stockage et des réexamens de sûreté des centres de stockage en exploitation. Il se prolongera pour accompagner le développement de ces stockages et de leurs phases de fermeture et de surveillance de façon à rester pleinement opérationnel en phase de post-surveillance.
Plusieurs pays dans le monde et en Europe se sont orientés vers la solution du stockage en couche géologique profonde et la pertinente de cette solution technique pour les déchets radioactifs à vie longue est reconnue au niveau international. L’Agence pour l’énergie atomique de l’OCDE*56 indique ainsi, dans une évaluation internationale de 1999, que « de toutes les options envisagées, l’évacuation en formation géologique profonde est le mode de gestion à long terme le plus approprié pour les déchets radioactifs à vie longue ».
L’AIEA* indique également, dans une publication57 de 2003, que « la sûreté du stockage géologique est largement acceptée dans la communauté technique et de nombreux pays ont maintenant décidé d’aller de l’avant avec cette option ». La directive 2011/70/EURATOM du conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs précise par ailleurs qu’« il est communément admis que, sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible considéré comme déchet ».
Les paragraphes suivants précisent l’état des lieux des recherches, études, et projets le cas échéant, menés dans certains pays qui se sont orientés vers le stockage en couche géologique profonde. Cette présentation est réalisée par ordre alphabétique.
Allemagne
Aucune installation de stockage de déchets HA* et de combustibles usés en couche géologique profonde n’a été construite en Allemagne. À l’origine, en 1977, l’Allemagne et la Basse Saxe lancent un projet nucléaire de grande ampleur (usine de retraitement, usine de fabrication du combustible, un entreposage et un stockage souterrain de déchets de haute activité) à Gorleben. Pour le stockage, il était prévu de stocker les déchets le dôme de sel gisant en profondeur et ayant fait l’objet d’une exploitation minière. Entre 1979 et 2000, des recherches et des investigations géologiques avancées du dôme de sel sont menées dans un contexte d’opposition croissante au projet et au nucléaire en général en Allemagne. En 2000, un moratoire gèle les activités de recherche sur site en attendant la clarification de points fondamentaux sûreté et de la mise en place d’une procédure transparente sur recherche de site de stockage.
En 2013, le “Repository Site Selection Act” (StandAG) ou loi sur la recherche d’un site de stockage des déchets HA* est adoptée, soit deux ans après la décision de l’Allemagne de sortir du nucléaire en 2022. Cette loi définit la procédure, basé sur la science et la transparence par laquelle la sélection d’un site de stockage en couche géologique sera établie à l’horizon 2031. En 2016, une nouvelle loi organise la gouvernance de cette recherche de site.
Depuis 2016, BGE (Bundesgesellshaft für Endlagerung) pilote un programme de recherche de sites pour un stockage géologique profond dans tous les types de roches hôtes. Le 28 septembre 2020, BGE a publié un rapport intermédiaire identifiant 90 sous-zones potentielles pour la mise en place de ce stockage. Ces zones sont issues de l’évaluation des données géologiques. La deuxième étape du processus consistera à poursuivre les recherches afin de réduire les zones potentielles pour lesquelles BGE a l'intention de mener une exploration de surface dans la phase II. La mise en exploitation du stockage géologique est prévue aux alentours de 2050.
En parallèle, Base pilote un processus consultatif, progressif et transparent. A la suite de la publication du rapport intermédiaire, un événement de lancement a été organisé en ligne les 17 et 18 octobre 2020. D’autres événements s’en sont suivis afin de présenter le rapport et de recueillir les différents avis.
Belgique
La Belgique a fait le choix de poursuivre les recherches sur le stockage géologique, et de ne pas procéder, dans l’immédiat, à la sélection d’un site en particulier. Aucune échéance réglementaire n’est fixée à ce stade. L’ONDRAF (Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies) est chargé du pilotage de ces programmes de recherche. Ces programmes s’appuient sur les résultats des recherches sur l’argile de Boom58 dans le laboratoire souterrain Hades, dont la construction a débuté en 1980, à 230 mètres de profondeur.
Entre 2011 et 2018, l’ONDRAF a proposé plusieurs versions de stratégies de gestion des déchets radioactifs, incluant notamment la solution de stockage géologique des déchets de haute et moyenne activités. La révision proposée en 2018 par l’ONDRAF/Niras prend en compte des demandes de l’Autorité de sûreté belge comme :
- une profondeur de stockage comprise entre 200 m et 600 m ;
- des mesures en vue de favoriser la flexibilité de la décision, la récupérabilité des colis et la surveillance du stockage ;
- une attention particulière aux aspects de sûreté opérationnelle.
Si la formation des argiles de Boom était clairement mentionnée dans les premiers plans stratégiques, la révision de 2018 ne fait plus mention de cette formation géologique.
Entre le 15 avril et le 13 juin 2020, une consultation publique nationale a été menée sur la destination finale des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. Ceci a permis à tous les publics d'examiner la proposition de politique de l’ONDRAF ainsi que le rapport sur les incidences environnementales qui l'accompagne, et de les commenter. La consultation a donné lieu à de nombreux commentaires, réactions et conseils qui ont été intégrés par l’ONDRAF. Sur ces bases, l’ONDRAF a établi une nouvelle proposition de Politique nationale qui a été soumise aux ministres fédéraux en charge des Affaires économiques et de l’Énergie à l’automne 2020. C’est à présent au gouvernement qu’il appartient de prendre une décision finale sur la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie.
Canada
Le plan de gestion des combustibles usés, son développement et sa mise en oeuvre sont encadrés au Canada au niveau législatif par le « Nuclear Fuel Waste Act59 » (2002). La gestion des déchets de faible et moyenne activité est régie par deux autres lois, le « Canadian Environmental Assessment Act60 » (2012) pour l’étude d’impact environnementale, et le « Nuclear Safety and Control Act61 » pour la préparation du site et la construction de l’installation de stockage.
Une démarche progressive de recherche (Gestion Adaptative Progressive, GAP, en 9 étapes) de solutions / sites pour les déchets canadiens a été engagée en 2007 sous la responsabilité de NWMO.
À ce jour, aucune installation de stockage en couche géologique n’a été construite sur le territoire canadien mais le Canada est actuellement à la recherche d’un site pouvant accueillir une telle installation destinée aux combustibles usés. Une société rassemblant les trois producteurs de déchets radioactifs canadiens, NWMO (Nuclear Waste Management Organization62 ), a été créée en 2002. Elle a pour mission de trouver, en accord avec les populations locales, un site susceptible d’accueillir une installation de stockage en couche géologique. Le processus de sélection du site sous l’égide du NWMO a débuté en 2010.
Actuellement, les candidatures de deux communautés (Ignace et South Bruce), situées en Ontario, ont été retenues pour accueillir le centre. NWMO poursuit ses campagnes de forage, son programme de concertation, et lance ses études d’impact environnemental et de sûreté (Etape 3 du GAP). Le choix du site de stockage sera fait en 2023 pour une mise en service en 2040-45.
Le Canada est également à la recherche d’un site pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité. Le processus a débuté en 2012 sous l’égide d’un groupe de travail mixte entre des membres de l’Autorité de sûreté canadienne (CNSC) et de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (CEA Agency). Après quatre années d’instructions du dossier déposé par Ontario Power Plant (OPG), le groupe a présenté ses recommandations au Gouvernement, qui a demandé des compléments en 2016 et 2017. En 2020, OPG a officiellement annulé son projet de stockage sur le site nucléaire de Bruce, à la suite du rejet du projet par la communauté autochtone locale. D’autres options vont être explorées par OPG et Natural Resources Canada et notamment les solutions de stockage à faibles profondeurs.
Chine
Aucune installation de stockage en couche géologique n’a été construite en Chine. Un projet de stockage des combustibles usés et des déchets HA* des activités civiles et de défense est actuellement à l’étude sur le site granitique de Beishan (province de Gansu) où un tunnel de recherche a été construit en 2015 et la construction d’un laboratoire à environ 560 m de profondeur a débuté à l’été 2021.
Parallèlement, la Chine conduit des recherches d’un site « argile » pouvant accueillir une installation de stockage.
États-Unis
La gestion et le stockage des déchets de haute activité et des combustibles usés sont encadrés aux États-Unis par la loi du « Nuclear Waste Policy Act63 » (1982).
Les États-Unis ont déjà sélectionné un site pour accueillir leur stockage en couche géologique profonde, situé à Yucca Mountain dans le désert des Mohave, à 140 km de Las Vegas. Le site est destiné à accueillir des combustibles usés. Sa construction est sous la responsabilité du Département de l’énergie (DOE). Toutefois, le projet a été fortement ralenti sous l’administration Obama, qui a déclaré que « Yucca Mountain ne constituait pas une option réalisable pour le stockage à long terme des combustibles usés ».
L’instruction de la demande d’autorisation de création déposée par le DOE, suspendue pendant quelque temps, a finalement abouti en janvier 2015. L’Autorité de sûreté nucléaire américaine (NRC), en charge de cette instruction, a considéré que le projet répondait aux standards de sûreté du pays, en relevant deux points qui doivent être complétés. Ceux-ci concernent l’obtention par le DOE d’une partie de la propriété du terrain pressenti, ainsi que des droits en matière d’eau nécessaires à la construction de l’installation. En 2016, la NRC a également demandé des compléments au DOE relatifs à l’impact environnemental du projet.
Cependant, le projet est actuellement gelé faute de financement.
Finlande
La « loi sur l’énergie nucléaire » (1987) encadre en Finlande la gestion et le stockage des déchets de haute activité et des combustibles.
La Finlande exploite depuis 2004 un laboratoire de recherche en couche géologique profonde situé à 400 m de profondeur, dans de la roche granitique. Il se situe sur le site de la centrale d’Olkiluoto au sud-ouest du pays.
À la fin de l’année 2015, le gouvernement Finlandais a autorisé Posiva, organisation privée chargée du stockage des combustibles usés des réacteurs nucléaires, à construire l’installation de stockage destinée à accueillir ces combustibles usés. Les opérations de creusement ont débuté en 2016. En 2019 et 2020, le creusement du tunnel central a été réalisé après validation par l’Autorité de sûreté finlandaise (STUK) de la conception détaillée. En 2021, Posiva a commencé la construction des tunnels dans lesquels les colis de déchets seront stockés64. Le 30 décembre 2021 Posiva a déposé un dossier de demande d’autorisation pour l’exploitation de son installation de stockage (posivasolutions.com/news.html). L’instruction de ce dossier sera également réalisée par STUK. Une fois que le gouvernement finlandais aura donné son accord, le stockage des colis de déchets dans ces tunnels pourra commencer.
Inde
Aucune installation de stockage en couche géologique n’a été construite en Inde. Une campagne destinée à identifier des sites potentiels a été menée, avec comme critère une capacité de stockage de 10 000 colis de déchets radioactifs. La solution privilégiée est celle d’un site granitique.
Japon
Un « Groupe de travail sur les déchets radioactifs » a été créé en 2013, dont une des missions est de susciter des candidatures pour accueillir une installation de stockage en couche géologique profonde.
Dans ce cadre, en juillet 2017, une cartographie du Japon a été publiée, représentant les régions qui répondent à certains critères techniques et géologiques, faisant d’elles des potentielles candidates à l’accueil d’une telle installation de stockage.
Des actions de communication à travers le Japon pour promouvoir la compréhension du projet de stockage géologique et de l'environnement géologique au Japon ont été réalisées par NUMO et le METI.
En octobre 2020, deux municipalités ont annoncé l'acceptation de recherche préliminaire – bibliographique - sur leur territoire, comme première étape de la proposition du gouvernement japonais de relancer le processus de sélection d'un site. Il s’agit des villes de Suttu et Kamoenai. Les deux sont situées dans la préfecture de Hokkaido, dans le quartier de la centrale nucléaire de Tomari de la compagnie d'électricité de Hokkaido.
Dans environ deux ans, les municipalités et le gouverneur de la préfecture de Hokkaido exprimeront leur intention de passer à l'étape suivante du processus. Cette prochaine étape, appelée « enquête préliminaire », peut inclure des travaux d'investigation du site comme des levés géophysiques et des forages.
NUMO prévoit une première sélection de sites potentiels d’ici 2025 et une mise en service du stockage d’ici 2035.
Royaume-Uni
Aucune installation de stockage en couche géologique n’a été construite au Royaume-Uni. La recherche d’un site potentiel a commencé à la fin des années 1970. Les oppositions locales et nationales ont conduit à l’abandon de ces recherches en 1981.
Une nouvelle consultation du public a eu lieu dans le début des années 2000, afin de relancer la démarche de recherche de site. Le Royaume-Uni a publié en 2001 un Livre blanc intitulé « Managing Radioactive Waste Safely - proposals for developing a policy for managing solide radioactive waste in the UK65 », qui annonce un plan et une organisation pour la gestion des déchets.
Paru en 2008, le Livre blanc « Managing Radioactive Waste Safely : A Framework for Implementing Geological Disposal66 » définit un cadre pour la mise en oeuvre d’un stockage géologique des déchets radioactifs de haute activité. En 2014, un nouveau livre blanc intitulé « Managing Radioactive Waste Safely - Implementing Geological Disposal67 » a actualisé et remplacé le Livre blanc de 2008.
Deux districts s’étaient montrés intéressés, mais ont retiré leur candidature en 2013 face au refus local. La construction d’un laboratoire de recherche à côté de Sellafield avait aussi été envisagée en 1997.
Un document intitulé « Implementing geological disposal – Working with communities68 » a été publié fin 2018 par le département de l’énergie anglais. Il décrit comment l’organisme en charge de la gestion des déchets, Radioactive Waste Management69, travaillera en partenariat avec les communautés locales, afin de trouver un emplacement approprié70 pour héberger une installation de stockage géologique.
À fin 2021, trois communautés ont exprimé leur intérêt pour le projet : Mid-Copeland, South Copeland et Allerdale.
Suède
La gestion et le stockage des déchets de haute activité et des combustibles usés sont encadrés en Suède par la « Loi sur les activités nucléaires » (1984) et la « Loi sur la radioprotection » (1988), ainsi que leurs textes d’application.
Une installation de stockage en couche géologique, destinée aux déchets de faible et moyenne activité à vie courte, est en exploitation en Suède. Celle-ci est localisée à Forsmark, sur la côte est de la Suède, au nord de Stockholm. Les alvéoles de stockage sont situées à 50 m de profondeur sous la mer Baltique, dans une roche granitique. L’installation appartient et est exploitée par SKB (Compagnie suédoise chargée de la gestion des combustibles et des déchets nucléaires) depuis 1988. L’Autorité de sûreté suédoise (SSM) a par ailleurs récemment rendu ses conclusions sur la demande de SKB d’étendre cette installation de stockage, afin d’y accueillir les déchets issus du démantèlement des installations nucléaires. Elle recommande à l’Autorité environnementale de rendre un avis favorable sur ce projet.
De plus, SKB a demandé l’autorisation de création d’une installation de stockage en couche géologique, destinée aux combustibles usés des réacteurs nucléaires. Le 23 janvier 2018, SSM et la Cour environnementale71 ont présenté leurs avis.
SSM recommande de répondre favorablement à la demande de SKB, au regard de la « Loi sur les activités nucléaires », alors que la Cour Environnementale, au regard du code de l’environnement, recommande la réalisation de nouvelles études clarifiant le comportement à long terme des conteneurs en cuivre, notamment au regard de la corrosion. Les résultats de ces études ont été transmises par SKB en avril 2019. La décision d’autorisation de création relève maintenant d’une décision du gouvernement suédois.
En vertu du code de l'environnement suédois, avant que le gouvernement ne prenne une décision finale, il a consulté les municipalités d'Oskarshamn et d'Östhammar, qui ont le pouvoir d'opposer leur veto à la demande. En juin 2018, le conseil municipal d'Oskarshamn a voté en faveur de la construction d’une usine d'encapsulation du combustible usé dans sa municipalité. En octobre 2020, le conseil municipal d'Östhammar a approuvé le stockage prévu à Forsmark.
La décision du gouvernement de lancer le projet a été annoncée le 28 janvier 2022 (skb.com/news/the-government-approves-skbs-final-repository-system/) et les autorités doivent définir les conditions de mise en construction du stockage avec une mise en exploitation vers 2030/35.
Suisse
La gestion et le stockage des déchets de haute activité et des combustibles usés sont encadrés en Suisse par la « Loi sur l’énergie nucléaire » et « l'Ordonnance sur l’énergie nucléaire » (2005). En 2008, le Conseil fédéral suisse adopte le Plan sectoriel qui fixe le cadre légal dans lequel va se dérouler le processus de sélection du site d’implantation d’un stockage géologique.
Aucune installation de stockage en couche géologique n’a été construite en Suisse. Deux laboratoires de recherche situés au Mont Terri dans une roche argileuse et au Grimsel dans un massif granitique sont exploités dans ce pays.
La Suisse est actuellement à la recherche d’un ou deux sites pouvant accueillir une installation de stockage pour les déchets de faible et moyenne activité, et pour les déchets de haute activité ou d’un site de stockage combiné.
Le processus de sélection a débuté en 2008 sous la coordination de l’Office fédéral de l’énergie (SFOE). La procédure suivie se décompose en trois étapes. La première étape (2008 - 2011) de la sélection des sites a permis de définir les grandes régions qui, du point de vue géologique, conviendraient à la construction de stockages profonds, en respectant les exigences de sûreté. La deuxième étape (2008 à 2018) a consisté à élaborer les projets de stockage et à comparer les six domaines d’implantation géologiques envisagés afin de les délimiter encore plus précisément. Le critère de décision prépondérant étant la sûreté du stockage. L’une des principales composantes de la deuxième étape a en outre été la participation régionale. À la suite des investigations réalisées par Nagra72 , des recommandations de l’Autorité de sûreté suisse (ENSI), et des conclusions de la Commission de sécurité nucléaire (CSN) et du Comité des cantons, trois sites ont été retenus par le Conseil fédéral Suisse : Jura Ost, Nördlich Lägern and Zürich Nordost. Le pays se situe actuellement dans la troisième étape qui doit conduire à la sélection d’un site pour le stockage géologique. Pour la Nagra, il s’agit d’étudier plus en détail les 3 domaines d’implantation potentiels. Ceci passe notamment par la réalisation de forages sur les 3 domaines. Elle a en outre pour tâche d’optimiser, en poursuivant sa collaboration avec les régions et les cantons, la conception des infrastructures de surface et de désigner des emplacements pour les installations d’accès auxiliaires.
En se fondant sur les résultats des études géologiques, la Nagra annoncera, en 2022, pour quels domaines d’implantation elle entend déposer des demandes d’autorisation générales pour un stockage de déchets de faible et moyenne activité, et un stockage de déchets de haute activité ou un stockage combiné. Il lui faudra environ deux ans pour élaborer ces demandes, qu’elle soumettra probablement en 2024. La procédure aboutira, vraisemblablement en 2029, à la décision du Conseil fédéral et à l’octroi des autorisations générales nécessaires pour les stockages profonds. La décision du Conseil fédéral devra être approuvée par le Parlement (environ 2030). Elle est soumise au référendum facultatif (vote sur l'éventuel référendum en 2031 environ).
56 Organisation de coopération et de développement économiques, fondée en 1948, jouant essentiellement un rôle d’assemblée consultative pour ses 36 pays membres.
57 The long term storage of radioactive waste: safety and sustainability - A position Paper of International Experts, AIEA* 2003, p.13.
58 La couche d’argile, dans laquelle le laboratoire Hades se situe, fait surface dans la commune de Boom, ce qui a donné son nom à l’argile de Boom.
59 Loi sur la gestion des combustibles usés nucléaires.
60 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
61 Loi sur le contrôle et la sûreté nucléaires.
62 Société de gestion des déchets nucléaires.
63 Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires.
64 À peu près 30 colis seront stockés.
65 Gérer les déchets radioactifs de manière sûre – propositions pour développer une politique de gestion des déchets radioactifs solides au Royaume-Uni.
66 Gérer les déchets radioactifs de manière sûre – un cadre pour la mise en œuvre du stockage géologique.
67 Gérer les déchets radioactifs de manière sûre – mettre en place un stockage géologique.
68 Mettre en place un stockage géologique – Travailler avec les communautés locales.
69 Organisme chargé de la gestion des déchets radioactifs au Royaume-Uni.
70 Écosse exceptée, dont la politique envisagée n’est pas le stockage en couche géologique profonde, mais le stockage en subsurface près du site de production.
71 En Suède, l’opérateur (SKB) dépose un dossier auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire et de la Cour environnementale compétente. Au terme de l’instruction, deux recommandations sont rendues. C’est le gouvernement Suédois qui, en s’appuyant sur les deux recommandations, prend une décision d’autorisation.
72 Nagra est une société coopérative Suisse, chargée de construire et d’exploiter le futur centre de stockage.